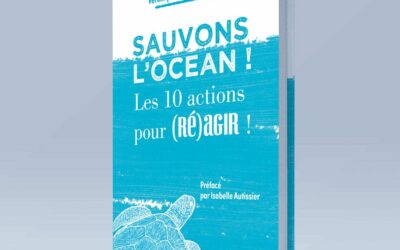Mer, rencontre extraterrestre… par Baptiste MORIZOT
Un texte à lire qui vous touchera. Une flèche décochée au cœur qui anime l’esprit . Baptiste MORIZOT, philosophe, auteurs de nombreux livres dont « Manières d’être vivant », nous révèle le fruit de son expérience à bord du catamaran de la mission Whaleway du programme La Voix des Cachalots. Prenez le temps de lire jusqu’au bout et de savourer.
Ce texte a également été publié en avant -propos du livre « Mer » publié par Reporters sans frontières
photos : Stéphane GRANZOTTO
un avant-propos de Baptiste Morizot.

Mer, rencontre extraterrestre
C’est un matin sur la mer d’huile, sur un voilier au large, pas de vent depuis deux jours, pas de houle, hors de portée de toute côte, inaccessible, et le ciel blanc comme un cercle posé sur tous les horizons, le silence, tout donne l’impression qu’on navigue désormais dans un autre monde, comme si une brèche s’était ouverte dans la nuit, entre deux vagues, quand on avait le dos tourné, comme si l’on avait pénétré sur une mer parallèle, un mer qui n’aurait jamais connu les humains, les sonars de sous-marins nucléaires, les filets fantômes dérivants, les moteurs caverneux des tankers – une mer originelle.
Nous sommes en Méditerranée pour la mission Whaleway : portée par l’association Longitude 181, commandée par les océanographes Véronique et François Sarano. Cette mission consiste à pister les cachalots depuis un catamaran, dotés d’hydrophones élaborés, de modèles informatiques pour une fois dédiés à l’amour du vivant, de drones détournés pour être délicats, de photographes aguerris. L’enjeu est d’enquêter sur les mœurs invisibles des cétacés, pour saisir les premiers brins d’une pelote qui est celle de leur écologie globale. Comment se tissent-ils à la vie dans une mer opaque, surexploitée, un foyer perforé des sons mécaniques qui viennent polluer leur milieu quotidien ? Comment rendre visibles ces formes de vie, ces parents mammifères retournés à la mer, et tenter de leur faire de la place dans notre monde commun.
Les photographes à bord ont pour mission de capturer dans leur viseur l’aileron dorsal, la nageoire, les flancs, comme dans un art du nu obsessionnel du détail, pour que l’on puisse dessiner sur la carte d’identification de chaque individu les moindres aspérités laissées sur son corps par la vie, et les reconnaître dans les prochaines heureuses rencontres. La photographie est un art des surfaces : elle tente de témoigner des profondeurs en captant sur un plan leurs indices visibles, et en ce sens, c’est un art de la mer, qui n’est pour l’essentiel pour nous que surface, miroir d’un monde invisible, où émergent ça et là ces signes de la vie profonde, immenses et dérisoires, dos-collines des cachalots, fleurissements de planctons, bancs-continents des grands thons, vite avalés à nouveau par les vagues. Comment par les images, ces cueilleuses de bouquets de signes, comment par les surfaces, faire exister d’autres profondeurs, d’autres mondes, dans l’espace de l’attention collective ?
Les journées ici sont rythmées par les quarts d’affût : sur le roof du bateau, les jumelles toujours aux aguets, on scrute inlassablement les horizons lointains et les plus intimes, pour voir émerger un instant un souffle, un vivant qui viendrait crever un instant la pellicule et nous révéler son fragment de monde.
Après deux heures de regard surchauffé sur du bleu, du vide, du bleu, et pour seule vie visible un oiseau migrateur un instant posé sur les haubans, il devient clair que même ici, dans une mer si arpentée, si connue, si usée par les tribulations humaines, nous sommes ailleurs. La mer est l’archétype du sauvage : on n’a pas domestiqué au sens fort une seule espèce vivant dans ce milieu ; il est surexploité mais pas organisé ; nous l’avons pollué mais pas aménagé ; nous l’avons abîmé mais jamais contrôlé ; nous l’avons exploré mais jamais colonisé ; et surtout, à la différence des milieux terrestres : on ne comprend pas vraiment jusqu’à son fonctionnement, on y est revenus à l’aube du monde, dans lequel on vit dans un milieu constitué d’un bouquet de forces inexplorées, inaccessibles, globales, mais immanentes et sensibles, quotidiennes. Des forces qui ne sont pas abstraites, dans le ciel, mais qui régissent pourtant toutes nos possibilités d’existence.

C’est cette condition qui donne à l‘océan ou à la mer comme milieu cette ambiance originale dans notre rapport au monde vécu. Ici la magnitude de l’incertitude par rapport au connu est colossale, c’est le temps et la mer qui décident, les forces en présence sont à accepter, à naviguer, à chevaucher, et jamais à mettre sous le harnais (c’est que c’est impossible). Et cela donne le sentiment d’un monde plus puissant que nous, on refait l’expérience du rapport de l’humanité au milieu vivant qui dominait jusqu’aux révolutions techno-scientifiques et philosophiques de la modernité, ni maitre ni possesseur, habitant fugace, dépendant, aveugles aux forces en présence, profitant de l’excédent d’énergie généré par la surabondance des forces vivantes, le bloom imprévisible des algues créant les cascades alimentaires qui font exister les poissons, par le jeu obscur des courants, sous la surface et depuis l’autre bout du monde. La vie sur terre est née dans la mer, elle s’est déployée ici des milliards d’années avant d’explorer le monde sec des continents, elle est plus ancienne ici qu’ailleurs, plus robuste, plus évidente, et plus inconnue. Du pont du bateau, nous scrutons la surface impénétrable, qui est aussi notre passé. La mer est un miroir sans tain : derrière la vie des origines nous regarde passer.
C’est pourquoi on a l’impression que même bardés d’instruments de mesure et de savoirs scientifiques, on est ici nécessairement dans un rapport chamanique au milieu, si comme le dit Roberte Hamayon, le chamanisme est un art de vivre dans l’aléatoire d’un monde qui nous dépasse. L’analogie du chamane avec l’océanographe, avec le scientifique qui piste les cachalots est spontanée : deviner l’invisible, et surtout, habiter l’aléatoire, l’imprévisible. Retour aux sources de la divination, mais outillée par nos meilleures méthodes scientifiques désormais. C’est bien du pistage animal, mais instrumenté de nouveaux sens qui prolongent notre corps humain.
Et c’est avec ces instruments, dérisoires et décisifs, que l’on essaie de capter comment ces formes de vie font monde. Une question centrale pour le futur par exemple, revient à documenter scientifiquement comment les cétacés sont impactés par l’usage des sonars de prospection minière, ceux des sous-marins militaires : ces sons humains quadrillant un univers qu’on croit vide viennent en fait polluer l’espace sonore le plus quotidien des cétacés. Or cet espace sonore est bien plus important pour eux qu’il ne l’est pour nous. Mammifères terrestres retournés à l’océan, la lignée des cétacés a dû renoncer à bâtir sa vie sociale et perceptive autour de l’œil terrestre, annulé par la mer vineuse, elle a dû inventer une forme de vie dont l’essentiel de la socialité, de la communication, de la perception, et même de l’action passe par l’écoute de l’écho des sons envoyés par l’animal lui-même : l’écholocalisation. Le cachalot ne voit pas les paysages sous-marins, il les entend, il leur pose une question par son biosonar et les reliefs lui répondent leurs formes, tout comme les proies et les congénères. Tout un univers vécu, de sens et de socialité, est présent dans le son. Or les nouvelles explorations minières de la mer défendues par les gouvernements, essentiellement la recherche très lucrative des minerais et des nodules polymétalliques, convoités par l’industrie high-tech, et présents sur le sol sous-marin, exigent des mesures de prospection qui utilisent des sonars très puissants, qui semblent capables à courte portée de détruire les organes acoustiques de ces animaux au point de les mener à la mort. Imaginez vivre dans un monde où au quotidien, dans votre salon et votre chambre à coucher, tous vos sens sont agressés aléatoirement par des sons stridents blessants les tympans, des images perforant les yeux et le cerveau, des lumières éblouissantes. Les environnements sonores que ces technologies font subir aux cachalots sont difficiles à saisir : les scientifiques montrent que dans certains contextes, ils sont analogues pour les cétacés aux tortures sonores que la CIA a inventé pour ses ennemis. Défendre les cétacés contre les sonars industriels et militaires, ce n’est pas protéger une espèce contre la chasse, ni préserver un milieu ou un habitat au sens matériel, c’est défendre un Umwelt sonore : leur monde vécu.
Se centrer sur la vie océane, essayer de voir par leurs yeux, de sentir le monde par leur sensibilité, transforme bien des perspectives sur la mer. Par exemple des questions aussi simples en apparence, mais abyssales en vérité que : l’océan est-il bleu ?
Les cétacés ne voient pas l’océan en bleu : la structure de leur œil le restitue dans d’autres teintes, pour partie inimaginable, mais qui est probablement dans les parages de nuances de gris, d’argent liquide et miroitant, de lumières et d’obscurité faites d’un métal mouvant. Il en est de même pour les poissons, les raies, les planctons dotés d’yeux, les crustacés, presque toute la vie océane qui voit : on ne sait pas de quelle couleur ils voient la mer, mais on sait que pour l’essentiel d’entre eux, ce n’est pas en bleu. Cela est scientifiquement documenté en psychologie comparée de la perception visuelle. L’océan est bleu pour nous, certes, pour un œil de primate terrestre, mais est-il bleu pour sa propre vie? Que veut dire être d’une couleur en ce monde ? D’une couleur pour qui ? La perspective de qui doit-on d’abord prendre en compte ? Pour ses habitants quotidiens, ceux pour qui c’est l’environnement donateur et le milieu de vie tissé, l’océan n’est pas bleu. Or ils les habitants de plein droit de la mer, plus légitimes que nous ne le serons jamais, conséquemment je le demande très sérieusement : l’océan est-il bleu?
Il n’y a de « planète bleue » que pour une des dix millions d’espèce qui la peuple, une espèce intéressante mais si récente, quand on sait que les requins existaient avant les arbres. Il y quatre cent millions d’années, la lignée-requin serpentait déjà dans les profondeurs sous leur forme presqu’actuelle, avant même que la vie terrestre n’invente la lignée des végétaux capables de monter vers l’azur, les arbres dont nous descendons. (Et le ciel d’azur, d’ailleurs, est-il bleu ? Est-il bleu pour ses habitants de plein droit, les oiseaux ?)
Ce matin-là, sur la mer d’huile qui n’est plus bleue, après deux heures de quart infructueux, la vigilance de notre affût interminable aux grands cétacés s’était émoussée de ne rien voir, de la chaleur, de l’immobilité, quand quelqu’un crie à l’avant : des ailerons, à 12h, ce sont des raies mobula !
Le catamaran s’ébroue vers elles d’un coup de barre tranquille, grand animal diesel, dinosaure plastique pour les dauphins du futur, et nous sommes à portée d’elles. Nous glissons dans la mer d’argent, nos corps augmentés par les grandes palmes d’apnée, les combinaisons, et les masques, toutes ces prothèses pour faire de nous un autre animal, un primate qui aurait renoué avec son ascendance marine, et nous sommes parmi elles. Nous croyons nager vers elles mais c’est elles qui avancent, à l’oblique, sur leur chemin, deux d’entre elles apparaissent dans la vitre du masque, puis trois, puis cinq, puis elles sont impossibles à compter dans le ballet anonyme de leur bande, et elles nous voient.
Et alors, alors que dans tout le corps sonne une alarme d’animaux habitués à faire fuir les autres animaux dans la rencontre,à repousser ceux qu’on désire approcher dans le seul geste de l’approche, alors qu’on attend cet instant où, nous voyant, l’animal sauvage s’enfuit à tire d’ailes, alors, elles bifurquent, elles infléchissent leur pur vecteur, d’un coup de frange du tapis volant que l’évolution a fait d’elles, et au lieu de disparaître, de nous fuir, elles se jettent vers nous, dans une ondulation paresseuse et fulgurante, elles sont là, elles glissent entre nous, d’un coup d’aile elles s’approchent presque à nous toucher, elles rondent autour de chacun en pointant leur œil noir sur nous, et au moment de disparaître encore, sur leur ligne d’erre, alors que l’inertie de leur mouvement les amènerait à prendre le large, elles font le mouvement conscient et volontaire de bifurquer en ployant les deux ailes, pour revenir à nous encore, et encore, et encore, pendant plusieurs dizaines de minutes, interminable comme un salut berbère.

On remonte sur le pont épuisés, essorés, vivifiés, perplexes. En silence, on défait les glissières des combinaisons dans le dos les uns des autres, les regards se croisent, incapables de formuler avec des mots ce que les yeux ont vécu et veulent pourtant dire, alors on sourit du bout des lèvres, et pour seul dialogue, on hoche un peu la tête, pour communier autour d’un vécu universel humain : « c’était quelque chose, hein ? » – oui, il s’est passé quelque chose. Chacun pourrait en raconter et en écrire sa version, chacun aurait raison, la plupart se taisent, comme si l’analyse, les mots, n’avaient pas les épaules pour faire justice à l’expérience, et probablement qu’ils ont raison – alors ici je veux faire autre chose avec les phrases : non pas prétendre retranscrire la « vérité » de l’expérience, avec sa tonalité affective de profonde signification et d’importance, phénomène pour lequel la langue française n’a pas de mot mais que la langue anglaise épouse parfaitement avec le mot « meaningfulness » ; mais écrire une version de l’affaire qui devienne une autre expérience – pour celui qui la lit, pour vous.
On peut toujours, c’est de bonne guerre, tenter de saisir les expériences plus grandes que nous en les reconstruisant comme une énigme, comme une cascade d’énigmes – c’est une manière de se demander : pourquoi cette-fois ci s’est-il passé quelque chose qui me dépasse ? Et les énigmes appellent une enquête, quand les expériences de félicité puissantes nous laissent comblés et cois – ce qui est moins généreux pour les autres, c’est pourquoi le primate originel revenant autour du feu, après sa journée riche dans la savane, a inventé l’évidence de raconter des histoires, et nous voilà maintenant.

Première énigme : pourquoi ces raies sont-elles venues vers nous ? Mais surtout, pourquoi reviennent-elles vers nous plusieurs fois après nous avoir identifié, après avoir déterminé que nous ne sommes ni menace ni proie, pourquoi encore et encore ? Alors même qu’elles et nous sommes postés si loin à la surface buissonnante du corail du vivant. « Elles sont curieuses », dit l’un d’entre nous pour contenir dans un mot le mystère débordant de l’événement vécu, mais « curieuses » ce n’est pas suffisant, ça n’explique rien : ce n’est pas la solution – c’est l’énigme.
C’est peut-être déjà que nous sommes aussi rares pour elles qu’elles le sont pour nous. C’est peut-être aussi qu’elles sentent notre impuissance, notre impuissance motrice, nous sommes ici des points fixes face à leur pure mobilité, même palmés, l’eau est pour nous d’une autre viscosité, il faut toute l’énergie d’un singe pour combler la distance qu’elles réouvrent d’un petit ploiement débonnaire de la peau. Nous ne pouvons ni les suivre, ni les fuir, ni les attaquer, ni les surprendre – l’impuissance de l’autre vous donne tout le temps de l’investiguer, comme un enfant un escargot. Et nous sommes l’escargot.
Et sentant cette innocuité à laquelle nous sommes rendus, elles ne se contentent pas de nous examiner une fois, elles s’éloignent d’un coup d’aile, et elles reviennent d’un coup d’aile, aussi gracieuses dans leur nage qu’élégantes moralement dans la rencontre, dans le premier contact. Pas de peur. Suffit-il de la rareté et de leur compréhension de notre impuissance pour faire cette rencontre ?
C’est qu’il y a la rareté de la rencontre avec nous humains, qui nous rend potentiellement intéressants, mais aussi la rareté de la rencontre en général au cours de leur vie de raie, dans l’immensité bleue du large, sans relief, sans espèces autres que microscopiques, par contraste avec la vie en forêt ou dans les eaux côtières, où chaque animal a tout le temps sous les yeux des dizaines de formes de vies différentes. Est-ce qu’il y aurait une convergence évolutive dans le rapport aux étrangers, partagées par les formes de vie qui vivent au quotidien dans des milieux monotones, abiotiques, minéraux, ou simplement pauvres en diversité et en individus ? Est-ce qu’il se passe ici quelque chose d’analogue avec les cultures de la rencontre qui courent chez tous les peuples humains des déserts : leur culte de l’hospitalité, leur soin dans le salut, leur respect de la rencontre, leur fascination pour l’étranger, celui qui vous tombe dessus, seule forme sur un fond uni, à l’horizon sur la dune de sable, dans la steppe, sur la banquise, après des jours sans avoir rencontré personne dans l’élément minéral. La monotonie du milieu vécu et sa pauvreté biotique peut façonner des formes de vie néophiles, hospitalières pour la nouveauté, à travers les frontières des espèces.
Mais ce n’est pas encore ça qui est le plus poignant dans leur curiosité, c’est autre chose, c’est un affect discret, presque innommable, que j’ai ressenti pendant cette rencontre : être lavé, baigné et régénéré, comme l’ablution des mains et du visage dans une source claire purifie après des jours dans la poussière – l’émotion d’être soulagé d’un poids, comme jamais une rencontre avec un animal sauvage terrestre, ne me l’a donnée – pourquoi ? C’est l’énigme que je veux pister désormais.
François Sarano me dit, au sortir de l’eau, alors que ses cheveux goutent encore, et que ses yeux ne sont pas encore revenus du monde d’en-dessous : « il y a une innocence chez elles, comme une naïveté ». C’est le premier indice à suivre, cette formule, ce mot qui semble venu d’un autre monde. Il y a une innocence chez ces mobula, une innocence concernant notre danger potentiel : c’est qu’elles n’associent pas l’hameçon, le filet, et nos corps de primates palmés dans l’eau, rien qui ressemble à nous ne les a jamais blessées, et elles ont peu rencontré, plein large, de singes en néoprènes. Et cette innocence produit un effet puissant : en ne nous fuyant pas, en revenant nous investiguer, elles nous attribuent la même innocence, comme si nous aussi, j’entends notre espèce, était innocente, non dangereuse, non mortelle. Alors que tous les animaux terrestres nous fuient d’avoir été chassés, piégés, détruits, elles se comportent envers l’humain comme s’il n’était pas le fléau qu’il sait être parfois. Il est assez régénératif de nager et d’interagir avec des animaux qui ne savent pas nos pires visages, qui semblent ignorer que nous sommes coupables de la destruction du monde, nous, les primates capitalistes – qui nous voient dans toute l’innocence de nos individualités, ici non coupables (car aucun d’entre nous n’a jamais massacré de mobula) et qui, ne réagissant pas avec méfiance, ne nous attribuent pas les crimes et la dangerosité que les autres animaux ont appris à associer au bipède. C’est bien sûr un malentendu, tous les peuples de primates humains ne sont pas coupables de la destruction du monde vivant, c’est une forme de vie historique et tardive qui est en cause, liée à la modernité industrielle et extractiviste avant tout, et à une philosophie de l’absolue prééminence des humains dans un monde de choses, un monde de vies multiples avilies en stricts moyens pour nos fins.
C’est là qu’on comprend à quel point nous sommes assignés à la violence et à la culpabilité de notre silhouette érigée par les animaux sauvage terrestres, avec cette puissance d’induction qui caractérise si bien leur intelligence animale : puisque tant d’humains nous ont pourchassés et détruits, alors je fuirai chaque humain. C’est là qu’on comprend que toutes les rencontres quotidiennes qu’on fait avec la faune sauvage sur terre, de la mésange qui explose en pépiant quand je fais un pas vers elle, de la buse qui s’enfuit quand j’arrête la voiture, du chevreuil qui s’efface dans le bruit des feuilles mortes avant même que je l’ai aperçu – toutes sont marquées, inconsciemment, par le sceau de notre infamie, non pas de notre espèce, mais d’un nombre suffisant de nos congénères pour que les autres animaux aient appris fondamentalement à craindre cette silhouette unique du bipède. Je n’avais jamais compris avant ce jour combien, à chaque fois que je marche en forêt, en individu qui n’a jamais piégé les blaireaux, multiplié les cartons sur des « nuisibles », empoisonné les loups et les vautours, en individu qui se croit innocent et avance du pas de l’amant vers la vie animale non humaine, à la recherche de cette beauté autonome et centrée – et que subitement je croise un renard, un renard qui s’échappe à tire d’aile des pattes de mon amour pataud, de mon désir d’interagir – combien à chaque fois je transportais avec moi toute la violence immémoriale et toute la peur séculaires que mes congénères ont fait peser sur ses congénères. Ce n’est pas moi qui suis le sujet de cette interaction manquée, c’est ma silhouette de bipède en tant qu’elle est associée dans sa mémoire, vécue ou héritée à un fléau, à un danger.
Mais là, ce jour-là, de l’autre côté du monde, c’est-à-dire sous la surface de la mer, le comportement de ces raies a défait le nœud qui noue ensemble mon individualité et ma silhouette d’animal debout, le nœud qui me fait arborer sur mon visage d’innocent tous les crimes passés et présents de mes pairs humains. Nous étions face à des animaux qui ne nous faisaient pas porter sur nos épaules le fardeau de mort de nos pères, de nos frères humains s’activant sur les chalutiers géants, de nos congénères actionnaires des compagnies de pêche industrielle.
Et dans cet instant de grâce, on n’est plus un humain, plus un primate, plus un bipède, mais une pure nouveauté mise en présence d’une autre dans la rencontre, un pur étranger sans encore d’ethnie, d’espèce, d’image associée, de poids du passé, de préjugé qui nous précède et nous défigure – on se prend à ressentir qu’on est bien innocent, pour quelques instants, dans le premier matin du monde. On entre en relation vibratile et réelle avec une espèce dont on s’est séparés il y a plusieurs centaines de millions d’années, une forme de vie qui a côtoyé les dinosaures, et dont le cerveau est si différent du nôtre que sa vie intérieure ressemble volontiers à une autre planète.
Les innocents ont ce pouvoir: leur regard sur nous nous rend innocents, et ce faisant, il nous rend meilleurs, parce que lavés un instant de notre culpabilité d’appartenir à la forme de vie tardive qui a tant détruit, on ressent brusquement comme un soulagement : le poids colossal que notre conscience de nos effets désastreux sur ce monde nous fait porter inconsciemment tous les jours s’évanouit, pour un instant seulement, comme un appel d’air qui débloque et déplie les omoplates en ailes immobiles. Cette légèreté, ce n’est pas celle de l’apesanteur de l’eau, c’est celle de se voir innocent, inoffensif, dans les yeux d’une des formes de vie que notre mode de vie détruit. Alors que nous ne nous pardonnons pas, elles, dans cette simple curiosité de ne pas nous fuir, de ne pas savoir, quelque part, nous pardonnent. Et ce faisant, tout change : ce soulagement soudain est désiré, cette légèreté imméritée devient désirable. Quand on baigne dans le regard des raies, on veut la mériter, devenir meilleurs, trouver la force quotidienne de lutter contre ce qui détruit ce monde – comme le regard sans jugement d’un enfant sur ses parents coupables de défaillance les force à devenir plus grands, à être enfin à la hauteur de l’innocence que leur attribue spontanément ces yeux. C’est la puissance étrange de l’innocence, elle ramène les coupables dans son sillage, elle dit en un regard : vous avez une deuxième chance.
Soutenir Longitude 181
et La Voix de l’Océan
Longitude 181 est une association financièrement indépendante. Grâce à votre soutien nous continuerons à Alerter sur les menaces qui pèsent sur l’Océan et Agir pour faire entendre La Voix de l’Océan
Même pour 1 €, vous pouvez soutenir LONGITUDE 181 et cela ne prend qu’une minute. Merci.